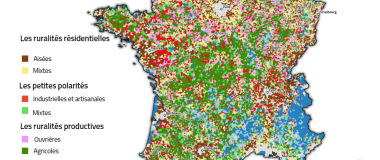Des chiffres, des analyses et des outils au service de la connaissance des territoires
Utilisez nos services
Carrefour des observatoires
Accès à l'annuaire et aux articles des acteurs nationaux et territriaux
Cartographie interactive
Réalisez vos propres cartes dans notre espace cartographique
Kiosque
Consultez et téléchargez nos publications
Visiothèque
Reprenez nos cartes et graphiques sur vos sites ou dans vos documents
Portraits de territoires
Obtenez et comparez les chiffres clés de votre territoire
Applications thématiques
Utilisez des applications accessibles pour répondre à des questions simples
Données ouvertes
Accédez à nos données statistiques et réutilisez les
Périmètre et zonage
A quel zonage de politiques publiques appartient votre commune ?